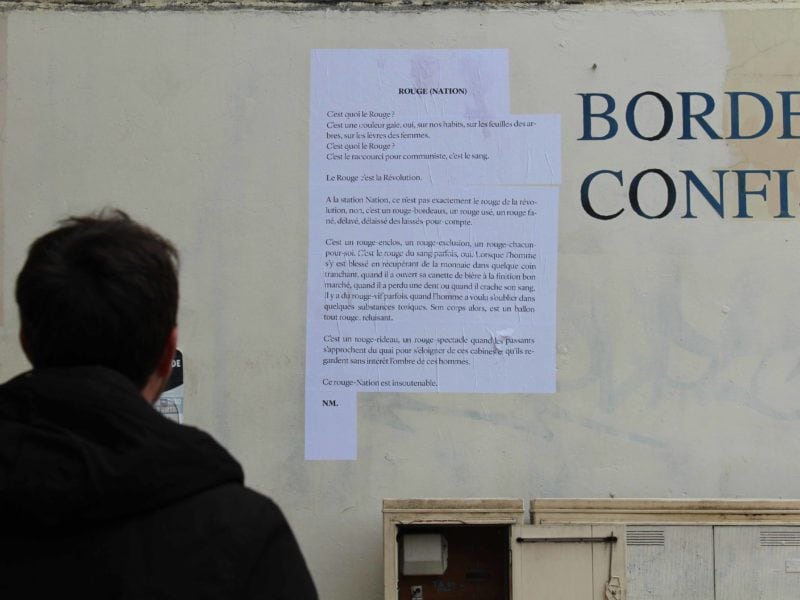Generación del 27
« La poésie française ne m’émeut pas. Je ne retrouve pas la même force qu’un Pablo Neruda, qu’un Antonio Machado ou même qu’un Miguel Hernández. Si, peut-être Robert Desnos. »
Je ne dis rien pendant une seconde. Longue, elle me parut. Je venais de revoir César, étudiant franco-espagnol, dans un café de la Place Saint-Michel à Bordeaux.
Je pensais : ces poètes que tu me cites ont quelque chose en commun, bien évidemment. Ce sont des convictions politiques qui les rassemblent et pour beaucoup un contexte historique désastreux : ils en seront les victimes.
Pablo Neruda (Ricardo Eliécer Neftalí Reyes-Basoalto, n’est-ce pas un nom magnifique ?) mourra « d’un cancer » quelques jours après le coup d’état de Pinochet. Qui ne sait pas que Pablo Neruda était communiste ? Antonio Machado meurt à Collioure d’épuisement en fuyant l’Espagne récemment franquiste. Bien évidemment il avait toujours défendu la Segunda República. Miguel Hernández dont les vers d’un poème que j’adore résonnent encore en moi « Cortar este dolor, ¿con qué tijeras ? » meurt de tuberculose dans la prison franquiste. Enfin, Robert Desnos, on le sait, était aussi communiste et meurt dans un camp de concentration en 1945.
Qui ne se souvient pas de ces quelques vers « J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité » ? Qui ne s’est pas lové dans les draps tièdes de sa chambre songeant, mélancolique, à quelques sentiments amoureux ? J’ai tant rêvé de toi…
Alors voilà, je n’étais pas d’accord. Même si je comprenais bien ce qu’il voulait dire.
Tout comme César, j’ai reçu une éducation bilingue.
Je suis rentrée en dernière année de maternelle en section bilingue à la Cité Scolaire Internationale de Lyon (c’est public). Nous avions cours de littérature espagnole et d’histoire de l’Espagne jusqu’au BAC (entre temps je suis allée vivre en Espagne et je suis passée par le Collège Cheverus et le Lycée Magendie à Bordeaux). Il faut dire que je lisais davantage en espagnol qu’en français, et surtout que j’écrivais beaucoup en espagnol. Transportée par le Siglo de Oro (Cervantes, Quevedo, et l’auteur (anonyme) qui écrivit ce bijou qu’est « El Lazarillo de Tormes » etc.), transcendée par la « Generación del 98 » (Antonio Machado en faisait partie) puis la « Generación del 27 » (pensons à Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti et son « ¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar !» mis en chanson par Paco Ibañez d’ailleurs).
Cette musicalité, cette force, ce vivre ou mourir, aussi, dans ce contexte-là, dans cette Espagne-là, ne peuvent pas laisser indifférent. C’est au-delà de la poésie, peut-être.
Toujours est-il que j’ai tout de suite pensé à Pierre Reverdy, Arthur Rimbaud, Jacques Prévert et François Cheng. Tout de suite, peut-être parce que je les lis à la radio (Ici-même) et que j’en ai un souvenir impérissable. Il y a quelque chose d’autre oui. Mais, peut-on comparer ?
Avons-nous conscience des blessures et brisures qu’une guerre (et une dictature) commet à la sensibilité ?
L’espagnol (el « castellano » car on y parle plusieurs langues) me manque. Voilà dix ans que je n’y ai pas mis les pieds. Dix ans. La dernière fois que j’y suis allée je mettais en scène Yerma que nous avions promue, avec une partie de la troupe, dans une télévision locale grenobloise. J’avais voulu que l’Espagne, le castillan, son rythme si particulier, sa manière de penser (une langue pense, oui), me pénètrent avant de continuer la mise en scène de la pièce de Federico García Lorca.
Il faut que j’y retourne.